|
Le projet culturel et historique du Pays des Écrins
pour l'été 2015 porte sur les vaudois, à l'occasion du 800e
anniversaire du 4e concile de Latran qui, entre autres décisions,
les déclara hérétiques. Le projet comporte diverses manifestations,
expositions et conférences, mais aussi le
film
cité en titre et en Références (juin
2015).
Celui-ci a déjà fait bondir tous ceux qui ont
quelques rudiments d'histoire locale et religieuse. Qu'en est-il
donc ?
Notre force est que le descriptif de chaque station a été rédigé
par nos soins, loin du papier glacé des Offices de Tourisme. -
See more at:
http://www.e-briancon.com/content/skionscom-un-media-sur-le-ski-100-haut-alpin.html#sthash.CLBTeUpI.dpuf
otre force est que le descriptif de chaque station a été rédigé
par nos soins, loin du papier glacé des Offices de Tourisme. -
See more at:
http://www.e-briancon.com/content/skionscom-un-media-sur-le-ski-100-haut-alpin.html#sthash.CLBTeUpI.dpuf
otre force est que le descriptif de chaque station a été rédigé
par nos soins, loin du papier glacé des Offices de Tourisme. -
See more at:
http://www.e-briancon.com/content/skionscom-un-media-sur-le-ski-100-haut-alpin.html#sthash.CLBTeUpI.dpuf
|
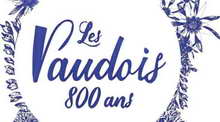
|
_______________
On
constatera que la définition du projet est quelque peu absconse sur un
sujet dominé par les légendes et sensible religieusement, d'où la
simplification en « Les Vaudois : 800
ans », transformée pour le film en « Les Vaudois : 800 ans d'hérésie ».
Ce titre, discuté plus loin, est fallacieux
et même tendancieux car il représente en lui-même un jugement et une
condamnation pour hérésie des vaudois sur huit cents ans, ce qui n'a pas
lieu d'être (1). Un titre
plus neutre comme « Les vaudois : 800 ans d'histoire » aurait mieux
convenu à ce qui devait ou aurait dû être l'objectif initial du film
(2).
_______________
Ce film a
été réalisé avec les moyens du bord, mais, loin d'être une
faiblesse, c'est une démarche intéressante qui associe des intervenants
locaux, que chacun aura plaisir à retrouver et qui s'en tirent plutôt
bien. Saluons donc leur performance et tirons leur un grand coup de
chapeau. Cela restera certainement une belle expérience pour eux.
Espérons toutefois qu’ils oublieront vite les quelques énormités qu’ils
ont parfois dû dire !
Car il faut
bien aborder le contenu du film. On est peiné de devoir constater qu'il
passe complètement à côté de l'objectif initial supposé de conter
l'histoire de 800 ans de valdéisme. Mis à part l'attribution légendaire
du « Barry de la Bâtie »
aux vaudois, toutes les autres légendes abandonnées depuis longtemps par
les historiens sont reprises dans le film ; des faits sont inventés de
toutes pièces ; un élément fondamental de l'histoire des vaudois est
purement et simplement oublié et les hors-sujets font perdre le fil.
_______________
Il commence
d'ailleurs par un hors-sujet de plus de cinq minutes, sur près de
vingt-cinq, qui porte sur l'histoire de l'Argentière et qui n'a rien à
voir avec les vaudois. Il mentionne en 1155 le nom
« Castrum Argenterie » que le dauphin
aurait donné au lieu, dont la première mention dans les archives
remontait jusque là à 1202 (3).
Cette séquence n'explique en rien
l'émergence du valdéisme dans les années 1170 à Lyon qui est introduit
sans aucune mise en perspective au bout de près de cinq minutes et demie
de film (4).
_______________
Les légendes concernant les vaudois ont été
nombreuses, le film n'évite pas la reprise de deux légendes les
concernant.
La première porte sur l'origine du nom
moyenâgeux de la Vallouise, « Vallis
Puta » francisé ultérieurement
en « Valpute ». Dans le film,
cette dénomination est attribuée à l’archevêque d’Embrun qui, en 1184,
constatant que la Vallouise était entièrement peuplée de vaudois, aurait
décrété dans une déclaration solennelle que la vallée devait s’appeler
« Vallis Puta » ou « Valpute ».
Manque
de chance, la vallée s’appelait déjà ainsi avant le début du
valdéisme (5), il n’y
avait pas encore un seul vaudois en Vallouise en 1184
(6) et la déclaration de l’archevêque
n’a jamais existé. Cette séquence est de l'ordre de l'invention pure
et simple, d'autant plus que l'archevêque est supposé mentionner en
1184 les conséquences de la bataille de Bouvines qui eut lieu en
1214, soit trente ans plus tard.
La
seconde concerne le fameux massacre des vaudois survenu en 1488
au-dessus d'Ailefroide. Il est qualifié dans le film de :
« génocide, l'un des plus sanglants de
l'histoire, (qui) videra les vallées de Vallouise, de l'Argentière
et de Freissinières de la quasi-totalité de leurs habitants. » On
est dans l'outrance puisque le nombre de morts est de moins de
quatre-vingts pour les historiens (7).
Par ailleurs, l'émigration provoquée par la persécution a été
complètement occultée alors qu'elle porte sur quelques quatorze
cents personnes venant des diocèses d'Embrun et de Turin, soit un
tout autre ordre de grandeur (8).
_______________
Encore plus
grave, mais il s'agit cette fois d'une omission : il n'est fait aucune
mention de la réhabilitation des habitants en 1509 et de l'instruction
qui l'a précédée.
La sentence, prononcée par le Grand conseil
du roi de France, cassait, annulait et infirmait toutes les sentences
prononcées à l'époque des persécutions ; réhabilitait les habitants des
vallées de l'Argentière, Freissinières et Vallouise, et du Val
Cluson ; les autorisait à recouvrer leurs biens et allait même jusqu'à
les disculper du délit d'hérésie (9,10).
Compte tenu de l'importance historique de cette réhabilitation,
plusieurs séquences auraient pu et auraient dû être tournées sur le
procès, sur le rendu de la sentence et sur ses suites.
De quoi aussi modifier le titre du film, d'autant plus que les vaudois
se sont ensuite fondus dans le protestantisme.
_______________
Bien qu'il
n'ait strictement rien à voir avec les vaudois, le film présente enfin
une séquence sur Félix Neff. C'est un autre hors-sujet qui reprend son
hagiographie traditionnelle, avec, bien sûr, la première école normale
d'instituteurs de France, alors que la première école normale remonte à
1794 à Strasbourg, puis à nouveau en 1810 et qu'il y avait treize écoles
normales en France en 1829 (11).
Encore une légende qui a la vie dure...
_______________
Le film
se termine en juin 2015 avec la demande de pardon du pape François
aux vaudois. C'est bienvenu de conclure sur cet événement, réédité
par l'évêque de Gap et d'Embrun dans l'église de Vallouise le 19
juillet 2015. Au-delà du geste officiel, que ce soit avec les
hussites le 15 juin à Rome ou avec les vaudois le 22 juin à Turin et
le 19 juillet à Vallouise, c'est la volonté de dialogue et de
rassemblement qui prévaut. On n'est plus depuis plus de deux cents
ans dans une logique de condamnation d'une hérésie et des
hérétiques. Il est donc regrettable de laisser entendre dans le
titre que l'hérésie se poursuit et que les vaudois sont toujours des
hérétiques alors que l'Église ne le dit
plus depuis longtemps
(12). L’Église
évangélique vaudoise a rejoint la communauté protestante et fait
aujourd’hui partie de l’Alliance réformée mondiale (13).
Elle doit être considérée comme une religion et non plus comme une
hérésie : « il ne s'agit plus de vaudois mais de protestants. (14) ».
En 2017, oserait-on mettre le titre :
« Les protestants : 500 ans d'hérésie »
(15)
?
Pour être complet sur
le sujet, il faut mentionner que le Synode de l’Église
évangélique vaudoise a répondu à la demande de pardon du pape, dans une
lettre, mardi 25 août, ne pas pouvoir se « substituer à ceux qui ont
payé de leur sang et avec d’autres souffrances leur témoignage à la foi
évangélique » et « ne pouvoir pardonner à leur place » (16).
_______________
On constate
donc que ce qui domine dans le film est une vision
fausse du valdéisme,
encore au stade de l'hérésie, qui s'appuie sur des faits erronés,
inventés ou légendaires. L'omission de la sentence de 1509 a fait
oublier que les habitants de nos vallées ont été réhabilités et
disculpés du délit d'hérésie (10).
Par
ailleurs, qu'il s'agisse de l'origine vaudoise de « Vallis
Puta », du massacre d'Ailefroide, ou dans un autre registre de la
première école normale de France, il conviendrait maintenant de dire :
ça suffit. Comme cela a déjà été fait pour le
« Mur des vaudois », il faut
arrêter de colporter ces âneries. La
crédibilité d'un projet culturel dans le Pays des
Écrins est à ce prix.
En guise de
conclusion, on peut reprendre la
réflexion tirée des
Tables rondes consacrées au tourisme durant l'automne 2012 et qui
avaient fait ressortir l'importance de la dimension patrimoniale dans le
tourisme local (17) :
« Le pays a
été très marqué par son histoire religieuse. Les vaudois ont suscité
bien des controverses et des légendes. Leur histoire fait partie du
patrimoine et ils intéressent beaucoup. On ne peut pas en parler sans
s'appuyer sur les données de l'histoire et on ne peut pas en parler en
occultant le message religieux transmis et sa survivance locale. »
Et encore :
« Le
patrimoine ne peut pas être abordé sans une rigoureuse approche
scientifique impliquant notamment l'histoire, l'archéologie et
l'anthropologie, voire la géologie (mines, carrières, ardoisières), la
glaciologie (blocs, roches moutonnées), la linguistique (langue
vernaculaire) ou la toponymie (noms de lieux).
»
« Une mise en valeur du
patrimoine ou un projet culturel ne peuvent donc se réduire à une
opération de communication superficielle qui se limiterait à sa
folkorisation et à son adaptation simpliste aux touristes mais
représente au contraire un travail en profondeur conséquent pour
permettre aux dits-touristes de comprendre les problématiques des
lieux visités. Ils ne pourront que s’y attacher. »
La réalisation d’un film sur les vaudois conforme à la réalité
historique n'aurait pas été plus compliquée mais aurait été bien
plus enrichissante pour tous. C'était très facile à réaliser, il
suffisait de faire relire le script...
(1) Ce
jugement et cette condamnation sont en particulier en complète contradiction
avec la demande de pardon du pape François. Voir aussi la note (12)
ci-après.
(2) Gabriel
Audisio a utilisé pour sa part un titre plus approprié
« Les vaudois : histoire d'une dissidence,
XIIe-XVIe siècle ».
(3) Une
mention plus ancienne que 1202 est plausible mais les noms de lieux ne se
forment pas de cette façon et pour que l'année 1155 soit enregistrée par la
toponymie comme première mention de ce nom, il conviendrait d'en référencer
la source.
(4)
L'émergence du valdéisme à Lyon tient beaucoup au contexte global et au
contexte local. Rubellin, 2003.
(5) Clouzot,
1923 ; Cézard, 1981.
(6) Marx,
1914 ; Paravy, 1993 ; Audisio, 2003.
(7) De
soixante à quatre-vingts. Paravy, 1993 et Desvignes-Mallet, 2015.
(8) Audisio,
2003.
(9)
« Non invenimus eos hereticos, nec a
fide pertinaciter devios », « nous ne les
avons pas vus hérétiques, ni s'écartant avec entêtement de la foi ».
Marx, 1914. La
« pertinacité de la déviance de la foi »
est le complément indispensable d'une hérésie. Ces deux morceaux de phrases
se renforcent mutuellement pour exprimer avec force l'absence d'hérésie et
de ses caractéristiques lors de l'instruction du procès de 1509.
(10) Le
valdéisme s'est toutefois maintenu en Briançonnais jusqu'à la Réforme et il
est vraisemblable que la masse des gens poursuivis se composait de vaudois
authentiques. Marx, 1914.
(11)
Wikipedia.
(12) Dans la
citation du pape, prononcée à la première personne, mais mise à la
troisième personne pour en faciliter la compréhension :
« [...] les comportements que les chrétiens
ont eu à l'encontre des vaudois », il conviendrait de remplacer chrétiens
par catholiques.
(13)
L'adhésion à la Réforme protestante marque la fin du valdéisme médiéval :
« celle-ci a entraîné l'abandon par les vaudois de leurs caractéristiques
religieuses médiévales : dès lors réformés, ils cessèrent de fréquenter
l'église paroissiale romaine, refusèrent les compromis qu'ils avaient admis
jusque-là, se dotèrent de temples et de pasteurs qui, à l'inverse des
barbes, récusèrent célibat et ministère itinérant. » Audisio, 2000.
C'est alors
une autre histoire qui commence : « Les
vaudois de Provence et du Dauphiné constituèrent la base solide de la
Réforme dans ces provinces, créant des paroisses protestantes de type
calviniste, c'est-à-dire synodopresbytéral. Il semble à peu près impossible
à l'historien de déceler une originalité religieuse quelconque des anciens
vaudois par rapport à leurs coreligionnaires. Leur caractéristique propre
est d'ordre non pas religieux mais socioprofessionnel ; contrairement aux
autres, ils étaient et demeurèrent paysans. Mais un trait particulier se
manifesta relativement tôt : les anciens vaudois piémontais devenus
protestants continuèrent à être appelés « vaudois », comme par le passé. Et
c'est bien après le XVIe siècle que la revendication du passé vaudois
apparut clairement dans l'appellation officielle de Chiesa valdese.
Rien de tel en France où le nom de vaudois se perdit. »
Audisio, 2000.
(14) Audisio,
2000.
(15) Une
hérésie résulte d'une condamnation par l'Église
catholique. Il n'y a plus guère aujourd'hui que des groupuscules intégristes
qui parlent encore d'hérésie.
(16)
L'Église vaudoise rejette le pardon
demandé par le pape, La Croix, 25 août 2015.
C'est une position qui peut se comprendre dans la
mesure où l’Église évangélique vaudoise n'a rien à voir avec le valdéisme
médiéval.
(17)
Vallouimages, Tourisme et
patrimoine, 19 novembre 2012. Ce document a été largement diffusé
soit sur internet soit en fichier pdf en direction des élus.
_______________
Références :
G. Audisio, Des Pauvres de Lyon aux vaudois réformés
in « Revue de l'histoire des religions »,
tome 217 n°1, 2000. Les vaudois. pp. 155-166.
G. Audisio, Les vaudois : histoire d'une dissidence, XIIe-XVIe siècle,
Fayard, 2003.
E. Cameron, The waldenses, Rejections of Holy Church in
Medieval Europe, Wiley, 2001.
M. Cézard, La Vallouise à travers l'histoire, Société d'Études
des Hautes-Alpes, Gap, 1981.
É. Clouzot, Pouillés des provinces d'Aix,
d'Arles et d'Embrun, Paris, Imprimerie nationale, 1923.
C. Desvignes-Mallet, L'église Saint-Étienne
de Vallouise à travers les âges, Éditions du Fournel, 2015.
J. Giraud,
Les Vaudois : 800 ans d'hérésie, Commune de l'Argentière-la-Bessée,
2015.
J. Marx, L'inquisition en Dauphiné..., Paris, H. Champion, 1914.
P. Paravy,
De la chrétienté romaine à la Réforme en Dauphiné, Rome, École française
de Rome, 1993, 2 vol.
M. Rubellin,
Église et société chrétienne d'Agobard à
Valdès, Presses universitaires de Lyon, 2003.
G. Tourn,
Les vaudois : l'étonnante aventure d'un peuple-église, Claudiana, 3e
édition, 1999.